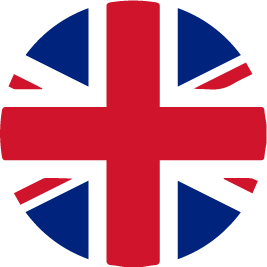Dans une ordonnance du 5 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Paris a considéré qu’était abusive la clause attributive de juridiction contenue dans les conditions générales du réseau social Facebook et désignant une juridiction californienne, et s’est donc déclaré compétent pour connaître du litige opposant les parties.
Lors de la création d’un compte Facebook, l’utilisateur est tenu, pour valider son inscription, d’accepter les conditions générales de la société Facebook, prévoyant notamment, en cas de litige, la compétence de la juridiction américaine. Dans le cadre d’une action intentée en France par un utilisateur à l’encontre de la société FACEBOOK, cette dernière a tenté de se prévaloir de ses conditions générales pour faire déclarer incompétentes les juridictions françaises.
Retenant que le demandeur ne faisait pas un usage en lien direct avec son activité professionnelle de son compte Facebook, le TGI a choisi de faire application de la législation relative aux clauses abusives afin de trancher la question de sa compétence. Se référant à l’article R132-2 du Code de la consommation aux termes duquel sont présumées abusives les clauses ayant pour effet de « Supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur », le TGI a considéré que la clause attributive de compétence était abusive et en a donc écarté l’application