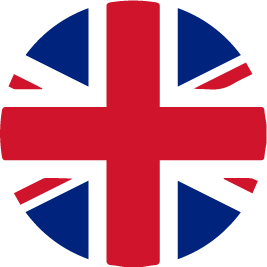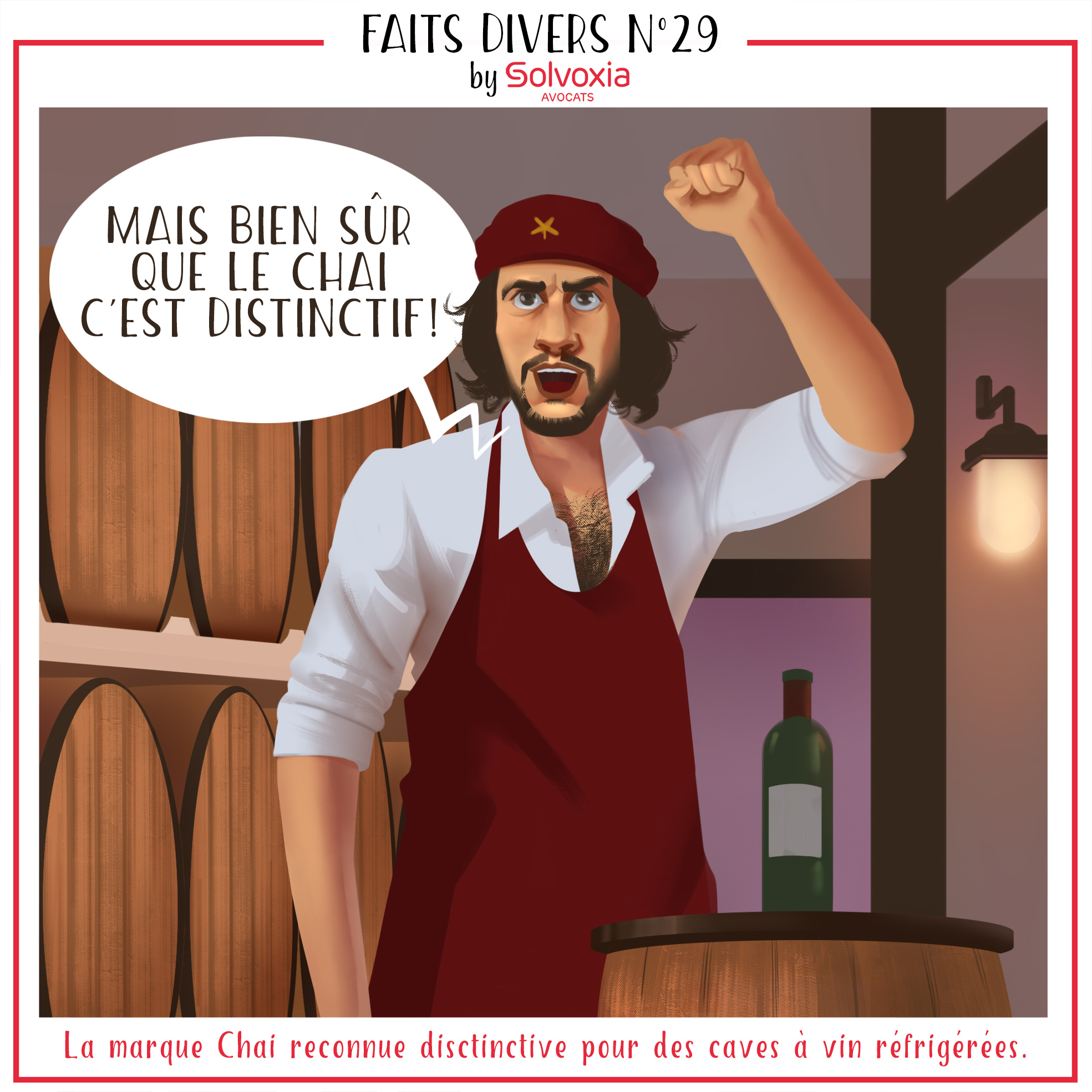Vous constatez qu’une autre entreprise utilise un nom similaire au vôtre pour une activité identique ou sur un marché proche, ce qui pourrait semer la confusion auprès de vos clients et prospects. Vous vous demandez alors si vous avez les moyens d’intervenir pour protéger votre identité et garantir l’exclusivité de votre nom. Dans ce contexte, le droit des marques peut offrir une réponse adaptée.
Une marque, qu’est-ce que c’est ?
Une marque est un titre de propriété industrielle qui a pour fonction essentielle de protéger tout signe utilisé pour indiquer, aux consommateurs, l’origine des produits qu’ils sont susceptibles d’acheter.
Contrairement à d’autres droits de propriété intellectuelle, notamment les droits d’auteur, une marque n’existe qu’à partir du moment où elle est déposée auprès d’un office (en France, il s’agira de l’Institut National de la Propriété Industrielle).
Une marque est toujours composée d’un signe (un nom ou un logo par exemple) ainsi que d’une liste de produits et/ou de services qu’elle vise, qui correspondront à l’ensemble des activités pour lesquelles son titulaire envisage d’utiliser sa marque.
Le droit sur la marque nait à compter du dépôt
Avoir déposé une marque ne signifie pas que l’on peut empêcher tout usage par un tiers d’un signe se rapprochant de celui que nous avons souhaité protéger.
Ainsi, il faut tout d’abord garder en tête qu’une marque est un droit qui n’existe qu’à compter de son dépôt : si un tiers utilisait le même nom que vous avant que vous ne l’ayez déposé, vous ne serez pas en mesure de l’empêcher de continuer cet usage.
Pire, ce tiers pourrait potentiellement venir menacer la validité de votre propre marque, puisqu’en principe une marque peut être annulée si elle porte atteinte à des droits antérieurs de personnes tierces (d’autres marques, mais également une dénomination sociale).
De la même façon, une marque est protégée pour une durée de dix ans (renouvelables, autant de fois qu’on le souhaite) : attention donc à ne pas laisser expirer sa marque, car cela entraine une perte de la protection pour tous les actes qui seraient ensuite commis par des tiers.
Le droit sur une marque est un droit territorial
Une marque est également un droit à portée territoriale : sa protection est limitée au territoire où elle a été déposée. Par exemple, une marque enregistrée en France ne protège qu’en cas d’utilisation d’un signe similaire sur le territoire français. Cependant, il est possible d’étendre cette protection à plusieurs pays simultanément. Une marque de l’Union européenne couvre l’ensemble des États membres, tandis qu’une marque internationale permet de sélectionner les pays où elle sera enregistrée.
Par ailleurs, la protection d’une marque est liée à une activité spécifique, définie par les produits et services qu’elle désigne. Par exemple, une marque enregistrée pour des chaussures pourrait interdire l’utilisation d’un signe similaire pour des chaussettes, mais elle ne pourrait pas empêcher une autre entreprise de l’utiliser pour des produits alimentaires.
Quand y a-t-il contrefaçon de marque ?
Une marque permet d’interdire à un tiers d’utiliser un signe similaire ou identique à la marque, pour des produits et/ou services identiques ou similaires.
Pour être une contrefaçon, cet usage doit être fait « dans la vie des affaires », c’est-à-dire dans un contexte commercial (et non un usage à titre purement privé).
Si tel est le cas, la contrefaçon dépendra ensuite du degré de proximité de l’usage fait avec la marque.
Ainsi, si c’est un signe strictement identique qui est utilisé, pour des produits et services identiques, la contrefaçon est immédiatement caractérisée.
À l’inverse, si le signe utilisé ne fait que ressembler à celui protégé par la marque, ou si les produits et services concernés ne sont que similaires à ceux désignés par la marque, une condition supplémentaire devra être remplie pour qu’il y ait contrefaçon.
Dans ce cas, il sera nécessaire de prouver que cet usage crée un risque de confusion dans l’esprit du public entre le titulaire de la marque et le tiers.
Pour évaluer ce risque de confusion, plusieurs critères devront être pris en compte, notamment le degré de similitude entre les signes (sur les plans visuel, phonétique et conceptuel), la proximité des activités, le niveau d’attention du public (qui sera plus élevé pour des produits ou services coûteux, par exemple) et le caractère vraiment distinctif de la marque.
Quelles démarches mettre en place face à une contrefaçon de marque ?
Si vous constatez qu’un tiers utilise un signe proche de votre marque, et que vous estimez que cet usage répond aux conditions de la contrefaçon brièvement exposées ci-dessus, plusieurs actions peuvent être mises en place.
Tout d’abord, il est important de s’aménager la preuve de la contrefaçon identifiée. Par exemple, si celle-ci a lieu sur Internet, il peut être utile de faire constater par huissier les adresses Internet sur lesquels les produits sont disponibles, pour éviter une suppression de ces pages une fois un contentieux engagé.
Si vous soupçonnez des actes de contrefaçon provenant de pays étrangers, il est aussi possible de faire une demande d’intervention auprès des douanes pour bloquer les produits identifiés et ainsi pouvoir confirmer ce soupçon.
Une fois les preuves récoltées, une action en justice pourra alors être engagée à l’encontre du contrefacteur, pour le contraindre à cesser ses agissements contrefaisants et pour solliciter l’indemnisation de votre préjudice (préjudice commercial, dévaluation de votre marque ou de l’image de votre société…).
Un point à garder en tête toutefois avant toute action : si votre marque est déjà enregistrée depuis plus de cinq ans au moment où vous souhaitez agir en contrefaçon, il est indispensable de vérifier avant toute chose que vous exploitez bien votre marque pour les produits et services pour lesquels elle a été déposée.
En effet, si tel n’est pas le cas, le contrefacteur pourrait soulever la déchéance de votre marque pour défaut d’usage sérieux, ce qui pourrait potentiellement entrainer la perte de votre marque !
Et si je n’ai pas de marque, puis-je tout de même agir pour protéger mon nom ?
Une marque n’est pas le seul droit susceptible de venir protéger un nom. Ainsi, même sans disposer de marque enregistrée, plusieurs autres fondements méritent d’être envisagés si vous avez identifié un concurrent utilisant un nom trop proche du votre :
- Dénomination sociale : le nom de votre société bénéficie également d’une protection à compter de son immatriculation et il est possible de l’invoquer sous réserve de démontrer un risque de confusion.
- Nom commercial / Nom de domaine : le nom utilisé à titre de nom commercial par votre société est également protégeable, tout comme le nom de domaine que vous avez réservé pour votre activité en ligne. La protection est toutefois ici plus restreinte que pour une dénomination sociale, puisqu’un nom de domaine ou un nom commercial ne sont protégés que si leur titulaire démontre qu’il en fait une exploitation allant au-delà du local. Il est également nécessaire de démontrer un risque concret de confusion.
Ces autres signes distinctifs, qui ne sont pas des droits de propriété intellectuelle à proprement parler, ne sont pas protégés par une action en contrefaçon mais par une action en concurrence déloyale, fondée sur la responsabilité civile « classique ».
Sur ce même fondement, il est également possible d’agir à l’encontre de tiers qui se placent dans votre sillage (par exemple dans leur communication, dans leurs collections de produits, etc) en leur reprochant des agissements dits parasitaires.
Pour en savoir plus sur la contrefaçon de marque et savoir si vous disposez de moyens d’agir, n’hésitez pas à contacter un avocat en droit des marques !