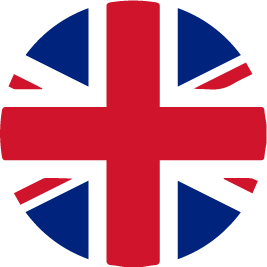Pour la 7ème année consécutive, Pierre LANGLAIS intervient au sein du Master 2 « Droit de la propriété intellectuelle » de l’Université de Nantes les 3 et 22 février 2016, sur la thématique des contrats attachés au droit des brevets.
Non, mais c’est une blague ?
Twitter a accepté de faire droit à la demande d’une tweeteuse réclamant, via un formulaire de notification en ligne, le retrait de messages publiés sur le réseau social, reprenant ses blagues. Sur quel fondement ? Le droit d’auteur.
En effet, en lieu et place des tweets « contrefacteurs », le message suivant s’affiche désormais : « Ce tweet a été retiré suite à une notification du détenteur des droits ».
Est-il donc véritablement possible de revendiquer la protection d’une blague tweetée au titre du droit d’auteur ? Cette question appelle deux séries d’observations.
En l’espèce, le message humoristique, conformément à la politique de Twitter, n’excédait pas 140 caractères. Or, le Code de la propriété intellectuelle (CPI) indique qu’une œuvre n’est protégeable que lorsqu’elle est originale et porte donc l’empreinte de la personnalité de son auteur. Est-il possible de considérer qu’en moins de 140 caractères, l’auteur d’un tweet peut faire rejaillir l’empreinte de sa personnalité ?
En réalité, la loi précise que sont protégeables « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Il n’y a donc pas de critère relatif à la longueur de l’œuvre. Ont ainsi pu bénéficier de la protection par le droit d’auteur des titres (de livres par exemple) ou encore des slogans.
Néanmoins, il est certain que plus le texte sera court, plus il sera difficile d’y déceler la « patte » de son auteur.
Le droit d’auteur ne protège pas les idées brutes, à moins qu’elles soient matérialisées sous une forme perceptible. La frontière entre formulation d’une idée et matérialisation sous une forme perceptible par les sens est poreuse dans la situation qui nous intéresse. En effet, les nouveaux médias comme Twitter permettent l’expression d’idées (quasiment comme à l’occasion d’échanges oraux) qui sont, au sens strict, matérialisées par écrit mais dépourvues de véritable concrétisation formelle.
Au final, tout dépend du contenu du tweet : s’il est original il sera considéré comme une œuvre et son auteur pourra donc en interdire la reproduction. A l’inverse, il ne sera pas protégé. Ainsi, dans une affaire similaire concernant une anecdote humoristique publiée sur le site VDM, le Tribunal de grande instance de Paris a jugé que « l’anecdote suivante publiée sur le site […] n’est pas originale dans sa forme, la concision du texte et la structure du récit ne révélant rien de la personnalité de l’auteur, seul l’événement relaté ayant un intérêt, et l’idée qu’elle véhicule peut librement être reprise sans commettre d’atteinte au droit d’auteur de celui qui l’a publié » (TGI Paris, 22/05/2014).
En tout état de cause, Twitter a privilégié la prudence et, conformément à ce que lui impose la loi en qualité d’hébergeur, a retiré le tweet notifié comme litigieux, sans pour autant en analyser le caractère réellement protégeable au titre du droit d’auteur. Pour cause, Twitter n’est pas juge.
Il serait en tout cas for intéressant que la question, concernant un tweet, soit soumise à une juridiction …
Comment défendre sa peau ?
Le 10 octobre dernier s’est tenue à Nantes la convention internationale de tatouage, l’occasion de faire un zoom sur cet art à part entière et les enjeux qu’il pose en termes de propriété intellectuelle.
Un tatouage peut être le résultat de trois démarches :
1. Le client sait exactement ce qu’il veut, le tatoueur exécute l’œuvre ;
2. Le client et le tatoueur discutent d’un concept, d’une idée, qu’ils formalisent ensemble dans un travail de collaboration ; ou
3. Le tatoueur a carte blanche pour développer sa créativité artistique.
Le code de la propriété intellectuelle pose que toute œuvre qui est matérialisée dans une forme perceptible et qui est originale, est protégeable par le droit d’auteur. Dès lors, un tatouage qui remplit ces deux conditions est une création, sur laquelle il est théoriquement possible de revendiquer des droits.
Pourtant le tatouage, en tant qu’œuvre de l’esprit, a pour singularité le support sur lequel il est fixé : le corps humain.
Le droit fait une distinction entre la propriété matérielle d’une œuvre et sa propriété intellectuelle. Contrairement à un tableau peint sur une toile, le support du tatouage a une « vie » indépendante de l’œuvre. Dès lors, comment articuler le droit de propriété sur l’œuvre et le respect de l’inaliénabilité et de la libre disposition qu’une personne a de son corps ?
Est-il envisageable pour un tatoueur de revendiquer la propriété d’un dessin qui est inscrit ad vitam aeternam sur le corps d’un tiers ? Si oui, faut-il qu’une fois la réalisation accomplie, le tatoueur signe un contrat de cession de ses droits d’auteur ? Peut-il s’opposer à ce que son client vende l’image d’une œuvre qui fait désormais partie de son corps ? A priori oui, comme en atteste une affaire concernant Johnny Halliday.
A l’inverse, si la création émane du « tatoué », peut-il interdire au tatoueur d’exposer l’œuvre ou de la reproduire sur une autre personne ? En pratique, oui.
Au-delà des questions habituelles que doit se poser un chef d’entreprise relatives à la protection de son enseigne, son site internet, son nom de domaine, de sa marque ou encore de son logo, le personnel des Tattoo Shop devra gérer des problématiques légales sur l’utilisation, l’exploitation voire l’exposition des œuvres créées par les tatoueurs…
Intervention du cabinet à l’Ecole Atlantique de Commerce de Nantes
Le cabinet est intervenu les 5 et 6 janvier 2016 à l’Ecole Atlantique de Commerce de Nantes dans le cadre du séminaire web 2.0.
Marques tridimensionnelles : briques lego rejetées mais figurines acceptées
Une marque tridimensionnelle ne peut être enregistrée à titre de marque si le signe est constitué exclusivement par la forme imposée par la fonction ou la nature du produit.
Après s’être vu refusé sur ce fondement le dépôt à titre de marque de la forme représentant sa brique fétiche, l’entreprise LEGO tient sa revanche en obtenant la validité de l’enregistrement à titre de marque tridimensionnelle de la forme des personnages LEGO.
En l’espèce, la société LEGO avait fait enregistrer auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) deux marques communautaires tridimensionnelles pour des jeux et jouets. Une société concurrente, BESTLOCK, avait demandé en 2012 la nullité des marques enregistrées en soutenant d’une part que la forme du produit serait imposée par sa nature même, et d’autre part que les figurines se conformeraient à des solutions techniques.
L’OHMI a rejeté les demandes en nullités, ce qu’a confirmé le Tribunal de l’UE le 16 juin dernier par le biais de deux décisions.
En effet, alors qu’en 2010 la CJUE avait considéré que les caractéristiques essentielles des briques Lego étaient exclusivement fonctionnelles (CJUE 14-9-0210 aff.48/09), le Tribunal opte cette fois-ci pour la solution inverse.
Ainsi, le Tribunal juge que « le fait que la figurine en cause peut être assemblée, grâce au creux sous les pieds, à des briques de jeux de la gamme Lego ne constitue ni un résultat technique, ni une caractéristique essentielle de la marque contestée » (point 33), et souligne que les caractéristiques essentielles de la forme (la tête, bras, jambes, pieds, etc…) avaient pour but de conférer une apparence humaine aux figurines et qu’aucun élément ne permet de considérer que ces éléments particuliers de la forme en cause répondent à une quelconque fonction technique.