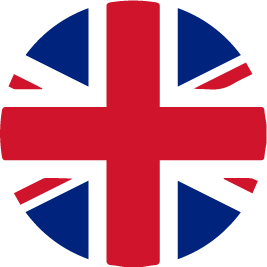Par un arrêt du 14 avril 2015, la Cour d’appel reconnait la distinctivité de la marque GIANT, supprime la marque de son concurrent, puis prononce la condamnation de ce dernier sur le terrain du droit des marques ainsi que sur le terrain de la concurrence déloyale.
La société QUICK est titulaire de la marque internationale GIANT, désignant notamment les classes de produits alimentaires, depuis 2006. En 2011, la société SODEBO a déposé, pour des produits identiques, la marque « PIZZA GIANT SOBEBO ». Estimant que cette marque portait atteinte à ses droits, la société QUICK a assigné SODEBO en contrefaçon et en concurrence déloyale. En retour, SODEBO invoquait la nullité de la marque « GIANT » pour défaut de distinctivité.
Pour justifier sa demande de nullité, SODEBO prétendait que la marque GIANT était descriptive car mettait en exergue les qualités du produit proposé sous cette marque. Les premiers juges ont donné raison à la société SODEBO et ont prononcé la nullité de la partie française de la marque internationale « GIANT », considérant que cette dernière n’était pas distinctive, le terme « GIANT » étant largement compris du public français comme signifiant « géant » ou « énorme », ce qui était descriptif des caractéristiques des produits et n’était dès lors pas distinctif. La société QUICK a fait appel de cette décision et la Cour d’Appel de Paris, dans son arrêt du 14 avril 2015, devait donc se prononcer sur la distinctivité de la marque « GIANT ».
La Cour d’appel est venue infirmer le jugement du TGI et a considéré que la marque « GIANT » était arbitraire et distinctive et conférait « une image positive à ses produits et services », sans informer directement le consommateur de l’une de leurs caractéristiques.